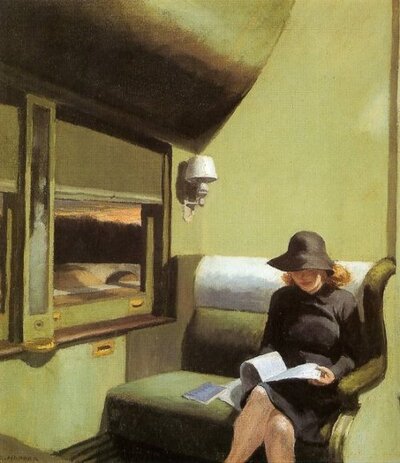Résumé du cours : La recherche de soi :
Problématique : La proposition est d’abord étonnante : un avis de recherche est lancé quand quelque chose d’important ou quelqu’un est perdu : son chat, son enfant…Celui qui lance l’appel est privé de son bien, il le recherche donc. Comment comprendre alors cet énoncé : « recherche de soi », ce qui supposerait que le soi est perdu mais qu’il se cherche lui-même ; sujet de la recherche et objet de la quête, étrange situation ! On sent qu’ici les mots n’ont pas le même sens. On ne se cherche pas comme on cherche son chat perdu, ni comme un amnésique recherche son identité, ni comme un enfant adopté recherche ses origines…toutes ces recherches supposent que quelque part un être réel, une réalité bien définie mais cachée, attende d’être dévoilée, mise au jour. Ôter le voile, trouver la cachette, lever l’anonymat…sont les opérations qui mettraient fin à cette recherche.
supposent que quelque part un être réel, une réalité bien définie mais cachée, attende d’être dévoilée, mise au jour. Ôter le voile, trouver la cachette, lever l’anonymat…sont les opérations qui mettraient fin à cette recherche.
Le Moi semble être en question, le mot comme nous disions ne garantit pas que le référent existe : la sirène se meut dans les mers des contes mais manque à l’appel ! Le Moi serait-il une fiction du même genre, dont on parle mais ne saisit jamais ? Le mot « Moi » est-il le nom d’une fiction, élaborée par une imagination débordante, romancière ou poétique
I) Le Moi existe-t-il ?
Dans cette 1ère partie nous avons établi :
-
On parle de soi comme d’un sujet voire comme d’ un objet : Je parle et je parle de Moi, je réponds à la question : « qui suis-je ?» comme à la question : «qu’est-ce que c’est ?» Mais je suis rapidement insatisfait de la réponse. J’ai rapidement conscience que le temps me change, que je suis plus complexe au présent, que je présente de multiples facettes. L’idée du Moi est trop figée, elle affirme une constance qui me manque, mais il faut bien que quelque chose demeure si je change…quoi ?
Étude du texte de Taylor (voir Textes étudiés).
-
Pour avancer nous avons compris la nécessité d’une archéologie du Moi : rechercher les sources de sa constitution, les forces qui ont construit cette réalité avant que nous soyons en mesure de l’interroger ou de la revendiquer. Il faut bien être quelque chose pour occuper un espace, faire partie d’un milieu géographique, social, politique et spirituel. Ce travail nous a montré que nous résultions des effets de nombreux discours.
-
Par l’éducation ou la transmission insoupçonnée, des représentations, des croyances, des sentiments, des jugements, des habitudes sont proposés ou imposés à chacun d’entre nous. Tout cela contribue à faire de nous des êtres familiaux, sociaux, politiques, capables d’être utiles aux autres. Par une forme d’archéologie nous pouvons reconstitué les effets de ces forces formatrices sur nous.
Étude du texte de Butler 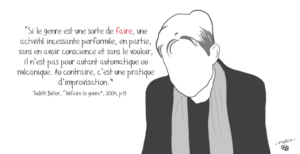 (voir Textes étudiés).
(voir Textes étudiés).
-
La notion de genre est un exemple total : elle contient des mises en forme qui concernent tous les milieux répertoriés ici. Et elle passe par tous les canaux : éducation directe ou inconsciente. Au bout du compte la sensation intime d’être une femme nous apparaît bien extérieure à ce qui seraient nos aspirations propres, nous avons intégré un milieu genré où nous occupons une place normée et spécifique et non naturelle et universelle.
Études des textes de Platon et Descartes (voir Textes étudiés).
-
Parmi les discours qui nous forment, nous avons examiné les discours philosophiques qui installent en notre culture la notion d’âme. On la trouve chez Platon ou Descartes, 2 auteurs qui ont construit notre pensée métaphysique. Platon pose l’existence de l’âme comme nécessaire à la compréhension d’un monde idéal, intelligible qui sert de référence à notre langage et qui garantit la vérité éternelle de nos jugements énoncés.
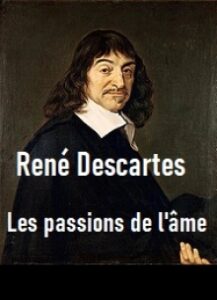 Descartes affirme l’existence de l’âme comme garantie de la connaissance absolue du monde, car elle a été harmonieusement conçue dans l’esprit du monde dont elle peut donner la lettre. Le corps ne donne aucune certitude, l’âme peut le faire par un engagement sans faille dans la quête de la vérité. Ces 2 discours métaphysiques nous ont beaucoup marqué : il reste dans notre culture (notamment par la religion qui a retenu cette notion) l’affirmation de l’existence de l’âme et la supériorité qu’elle est censée fonder. La sensation du Moi n’est pas étrangère à la force de ce discours métaphysique. Bien sûr d’autres discours existent, matérialiste, et nous donne l’opportunité de problématiser cette croyance.
Descartes affirme l’existence de l’âme comme garantie de la connaissance absolue du monde, car elle a été harmonieusement conçue dans l’esprit du monde dont elle peut donner la lettre. Le corps ne donne aucune certitude, l’âme peut le faire par un engagement sans faille dans la quête de la vérité. Ces 2 discours métaphysiques nous ont beaucoup marqué : il reste dans notre culture (notamment par la religion qui a retenu cette notion) l’affirmation de l’existence de l’âme et la supériorité qu’elle est censée fonder. La sensation du Moi n’est pas étrangère à la force de ce discours métaphysique. Bien sûr d’autres discours existent, matérialiste, et nous donne l’opportunité de problématiser cette croyance.
Fiches synthétiques : La recherche de soi
|
Cours du Jeudi 12/09 : |
Moi … qu’on a perdu ? Ou qu’on n’a pas encore découvert ? Problèmes : a) Le même qui cherche et est cherché, comment est-ce possible ? Cela n’indique-t-il pas que nous refusons de voir ce qui est là et cherchons un fantasme, un fantôme… b) « Moi » : de quoi parle-ton ?
|
|
Cours du mercredi 17/09 : À venir : |
-Une réalité empirique, constatable, descriptible, dont atteste la sensation, le sentiment que quelqu’un est irremplaçable. De quoi est faite cette identité incomparable ?
Qui suis-je ? La question de l’identité. La description de sources dont Je suis issu. Ce terme est une métaphore : je proviens de cette force qui me traverse mais ne s’arrête pas à moi, ainsi on met en avant : l’origine de ma famille, le choix de faire ses études fait bien avant, les traits de caractères dont notre conduite fournit de nombreux exemples, les réactions inévitables dont mon tempérament se composerait… Cette description néglige le fait qu’il s’agit plus de choix répétés que de caractères fixes, de généralisation que de constat. Pour retracer ces processus de composition du Moi il nous faudra utiliser les sciences de l’homme, pour passer de la conscience de soi à la connaissance de soi. De la certitude sensible d’être un Moi il nous faut réfléchir à la pertinence d’établir un portrait honnête et complet d’un individu unique, identique à soi et stable au travers de ses changements.
Que s’est-il passé depuis que je suis né ? Quel événement pour autrui a-t-il eu lieu ? Comment mon existence a-t-elle alors été investie par mes proches et les autres ? Quels discours m’ont formé ? Quels usages ? Quelles pressions affectives et sociales ; quelles lois ont exercé sur moi leur pouvoir de normalisation ? Cette archéologie s’appuie donc sur les sciences humaines et la philosophie qui nous donnent les clés de la compréhension de ces mécanismes d’élaboration. Sociologie (Bourdieu), psychanalyse (Freud), philosophie (Butler) sont autant d’outils de connaissance de soi (dans sa dimension générale), laissant dans l’ombre ce qui a pu échapper à la normalisation (ex : douleur de l’a-normal, mais aussi l’inconscient du normal). |