Introduction :
 H.D.Thoreau (1817-1862)Walden ou la vie dans les bois (1864) : retrouver la continuité avec les êtres naturels et explorer toute la gamme de nos possibilités d’existence.
H.D.Thoreau (1817-1862)Walden ou la vie dans les bois (1864) : retrouver la continuité avec les êtres naturels et explorer toute la gamme de nos possibilités d’existence.
Au début du 19ème les Etats Unis sont encore un pays neuf, composé d’une nature exubérante, extrême, mais aussi accueillante, calme ; elle offre une expérience très riche. Dans cet espace incomparable, les nouveaux arrivants prennent un nouveau départ, ils peuvent avoir la sensation de choisir leur vie, de la construire de A à Z, économiquement et politiquement. Tout semble encore possible. La démocratie américaine est certes déjà pourvue d’une constitution mais de nombreux problèmes ne sont pas encore réglés : la guerre pour annexer des terres, l’esclavage, la coexistence avec les amérindiens, sont autant de questions épineuses. Le développement technique est déjà un moyen d’entreprendre l’exploitation de la nature mais les finalités de l’existence humaine demeurent une réflexion ouverte. Pour reprendre un concept d’Hannah Arendt, la nature n’y est pas encore un « monde », un berceau préparé par les anciennes générations pour accueillir les nouvelles. Là-bas chacun se frotte plus ou moins à la sauvagerie : la nature non interprétée ou non modifiée.
Thoreau n’est pas un trappeur, un homme des bois à l’origine, il est diplômé de Harvard, la grande université de Boston, il a dirigé une école et enseigné pendant quelques temps mais n’a pas persévéré. Il a travaillé dans la fabrique de crayons de son père, mais là encore il n’a pas trouvé sa vocation. Il marche dans les forêts de la Nouvelle-Angleterre, il descend les rivières en canot, il étudie les oiseaux et les plantes, et surtout il médite sur l’existence digne d’un homme. Pour aller jusqu’au bout de cette expérience intérieure, il s’installe seul dans la forêt : il veut comprendre comment il est vivant, ce que signifie être vivant au sein de la grande vie naturelle, en relation avec les autres êtres et les autres formes de la vie. Il veut sentir le besoin de vivre seul ou dans la société ; il veut éprouver le désir de compagnie mais pouvoir évaluer si cela suppose un sacrifice. Il veut savoir si ça vaut la peine de vivre en société et de à quelles conditions.
Au bout de 2 ans il retourne dans la société, mais il ne renonce pas à sa conscience : il n’obéira qu’à condition que sa conscience soit en harmonie avec la loi. Il est à l’origine de la désobéissance civile (la désobéissance pour revendiquer une loi plus juste )qui continue aujourd’hui à être une idée utile à la réforme démocratique. Il a choisi de vivre sans entrer dans le monde frénétique des producteurs-consommateurs. Dans la nature, il n’a pas trouvé la solitude qu’il anticipait : quelque chose de vivant toujours l’accompagnait, il espère que la société ne soit pas au contraire le lieu où la solitude assèchera sa vie par manque de source, de vent, de force insufflée par le chant des oiseaux, de couleur miroitante à la surface de l’étang de Walden…
I) La nature humaine est-elle nécessairement sociale ?
- Poser le problème :
Partir de l’individu pour aller vers la société ou l’inverse ? Quels problèmes pose chaque solution envisagée ? Quelles références philosophiques ?
A) Aristote La Cité naturelle : le bourgeonnement social de l’homme.
Dans l’origine, la tension nécessaire vers la fin.
Les fins inscrites dans la force de se développer et de réaliser chaque étape de la vie sociale.
Les contradictions internes du modèle (nature inégale, des forces interpréter par des valeurs ; une université déniée et une relativité inassumée).
Une pensée persistante dans toutes les lectures naturalistes de la société. La dénégation par le réel même de l’insuffisance de la pensée naturaliste.
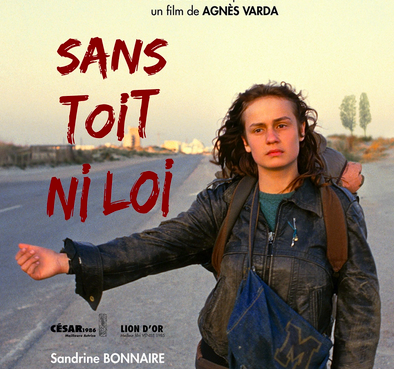
Commentaires récents